 Durant les années 20, dans une petite ville très collet-monté de la Nouvelle-Angleterre, Henry, un jeune lycéen, découvre la liaison adultérine qu’entretiennent deux de ses professeurs. Bien des années plus tard, le narrateur, une fois adulte et âgé, se remémore l’arrivée éclatante de Miss Channing dans son lycée, une professeure d’arts plastiques à la beauté magnétique qui fascinera autant qu’elle ébranlera la moralité rigide de l’établissement pour garçons, Chattam, par sa soif d’indépendance. La jeune femme célibataire s’éprendra de M. Reed, un professeur de lettres marié et taciturne, revenu estropié et traumatisé par la guerre… Cette relation clandestine observée par le prisme d’Henry, un adolescent naïf, aura des répercussions dramatiques sur la petite communauté puritaine. Le Noir-Etang deviendra le théâtre d’un meurtre glaçant qui bouleversera à jamais le narrateur, complice malgré lui de cette tragédie…
Durant les années 20, dans une petite ville très collet-monté de la Nouvelle-Angleterre, Henry, un jeune lycéen, découvre la liaison adultérine qu’entretiennent deux de ses professeurs. Bien des années plus tard, le narrateur, une fois adulte et âgé, se remémore l’arrivée éclatante de Miss Channing dans son lycée, une professeure d’arts plastiques à la beauté magnétique qui fascinera autant qu’elle ébranlera la moralité rigide de l’établissement pour garçons, Chattam, par sa soif d’indépendance. La jeune femme célibataire s’éprendra de M. Reed, un professeur de lettres marié et taciturne, revenu estropié et traumatisé par la guerre… Cette relation clandestine observée par le prisme d’Henry, un adolescent naïf, aura des répercussions dramatiques sur la petite communauté puritaine. Le Noir-Etang deviendra le théâtre d’un meurtre glaçant qui bouleversera à jamais le narrateur, complice malgré lui de cette tragédie…
Voilà un roman noir estampillé policier qu’il me tardait de découvrir et il faut le reconnaître le temps morose normand de ces derniers jours se prêtait particulièrement à cette lecture romanesque emprunte de mystères. L’atmosphère pesante très austère qui s’en dégage rappelle d’ailleurs beaucoup les œuvres de Daphne du Maurier, en particulier Ma cousine Rachel. Et effectivement cet angle là ne nous déçoit pas. L’ambiance sombre à souhait est ainsi admirablement bien rendue et l’auteur décrit avec maestria le climat ambiant particulièrement empesé de la petite communauté de Noir-Etang. Les mauvaises langues y vont bon train, notamment chez la gente féminine… Par ailleurs, Thomas Cook nous dépeint habilement en filigrane une époque poussiéreuse ancrée dans une morale puritaine inflexible où l’adultère semble encore pire que le meurtre. J’ai été abasourdie d’apprendre que dans les années 1920 aux Etats-Unis, une femme était passible de prison ferme pour avoir violé son serment de fidélité ! Cet aspect du roman entre en résonance avec l’œuvre cinématographique magistrale de David Lean, La fille de Ryan, qui prenait pour toile de fond le contexte de l’Irlande au cours de la Première Guerre mondiale, en 1916. L’héroïne était tout comme Miss Channing une femme passionnée, étouffée par une morale trop corsetée, victime de ses amours interdits aux conséquences désastreuses. Ce personnage féminin malmené m’avait bouleversé.
Je m’attendais donc à y trouver une finesse psychologique analogue ; malheureusement si l’écrivain a privilégié une ambiance très hitchcockienne, il semble qu’il ait négligé au passage ses personnages qui restent d’un bout à l’autre du livre embourbés dans des stéréotypes. D’une beauté désarmante, Miss Channing incarne l’héroïne romantique désespérée à la personnalité énigmatique. Cependant, au grand désarroi du lecteur, le romancier tente vainement de lui donner une certaine profondeur mais sans véritable succès. Elle fait en effet tristement pâle figure face à la personnalité ambiguë de Catherine Ernshaw (Les Hauts de Hurlevent) ou même de Rachel (dans le roman éponyme Ma cousin Rachel). Son personnage demeurant trop inaccessible jusqu’à la dernière page, il est de ce fait impossible de s’y attacher véritablement. L’auteur la dépeint en effet avec le regard détaché et superficiel d’un homme admirant un bel objet d’art ; les sentiments de Miss Channing sont toujours dissimulés derrière un masque de froideur et d’indifférence alors qu’il aurait été intéressant de déceler une certaine vulnérabilité dans son tempérament en s’attardant davantage sur ses pensées. Mais l’auteur a choisi de se focaliser sur la narration de Henry, un personnage omniscient. Quant à Monsieur Reed, il représente le personnage masculin un brin cliché, tourmenté par son passé de soldat. Ses origines sont totalement passées sous silence. Dommage car une fois de plus elles auraient sans doute permis d’apporter davantage de relief à sa personnalité.
La lecture de ce livre m’aura du moins renvoyée à l’évocation du roman d’ambiance de Pierre Benoît, Mademoiselle de la Ferté, une œuvre où il ne se passe pas grand-chose, mais où tout est suggéré. Les personnages étant toujours statiques, cette lecture un peu passée de mode s’était révélée tout aussi frustrante.
 En bref : Thomas Cook a voulu se frotter aux œuvres classiques victoriennes du XIXème siècle. L’exercice de style est d’ailleurs presque réussi, la plume de l’auteur est élégante et l’usage de prolepses dans la narration permettent de donner un certain rythme à l’intrigue même si elle demeure relativement lente. Toutefois, c’est peut-être là que le bât blesse, ce drame psychologique reste trop fade à mon goût. J’espérais y trouver une histoire d’amour désespérante au romantisme échevelé, similaire aux œuvres des sœurs Brontë. Mais non, il n’en est rien. L’écrivain a tenté de mystifier un vulgaire fait divers et a négligé l’essentiel du roman noir, à savoir une héroïne charismatique et inoubliable. Autre point noir, le dénouement est trop expéditif. Il y avait tellement de bonnes idées d’écriture mais elles se sont révélées finalement mal troussées car trop superficielles. Et pourtant les thématiques étaient potentiellement intéressantes, telles que le crime passionnel et la culpabilité pesante d’un narrateur aux idéaux bien trop romantiques, et dont le rôle n’est pas non plus tout à fait innocent dans cette affaire sordide… Sans faire de véritables remous, Au lieu-dit Noir- Etang se lit malgré tout relativement bien. Amateurs de belles plumes, ce roman est fait pour vous !
En bref : Thomas Cook a voulu se frotter aux œuvres classiques victoriennes du XIXème siècle. L’exercice de style est d’ailleurs presque réussi, la plume de l’auteur est élégante et l’usage de prolepses dans la narration permettent de donner un certain rythme à l’intrigue même si elle demeure relativement lente. Toutefois, c’est peut-être là que le bât blesse, ce drame psychologique reste trop fade à mon goût. J’espérais y trouver une histoire d’amour désespérante au romantisme échevelé, similaire aux œuvres des sœurs Brontë. Mais non, il n’en est rien. L’écrivain a tenté de mystifier un vulgaire fait divers et a négligé l’essentiel du roman noir, à savoir une héroïne charismatique et inoubliable. Autre point noir, le dénouement est trop expéditif. Il y avait tellement de bonnes idées d’écriture mais elles se sont révélées finalement mal troussées car trop superficielles. Et pourtant les thématiques étaient potentiellement intéressantes, telles que le crime passionnel et la culpabilité pesante d’un narrateur aux idéaux bien trop romantiques, et dont le rôle n’est pas non plus tout à fait innocent dans cette affaire sordide… Sans faire de véritables remous, Au lieu-dit Noir- Etang se lit malgré tout relativement bien. Amateurs de belles plumes, ce roman est fait pour vous !

 Dans une étrange bibliothèque du Finistère où les auteurs déchus viennent déposer leurs manuscrits refusés, une jeune éditrice ambitieuse découvre par le plus grand des hasards un chef-d’œuvre littéraire délaissé. Enthousiasmée par cette trouvaille inédite, elle décide de le publier. Le roman remporte très vite un franc succès… Mais son mystérieux auteur, Henri Pick, pizzaiolo de son état, n’aurait selon son épouse jamais écrit de livres ; pire, il n’était pas particulièrement féru de littérature. Un critique illustre, un brin sceptique, doute de la légitimité de l’auteur… Comment Henri Pick aurait-il eu le temps d’écrire un tel chef-d’œuvre entre deux fournées ? Avec l’aide inopinée de la fille de l’énigmatique auteur, le journaliste critique Jean-Michel Rouche enquêtera pour découvrir le fin mot de l’histoire, au risque de mettre en péril sa propre carrière tout comme sa réputation…
Dans une étrange bibliothèque du Finistère où les auteurs déchus viennent déposer leurs manuscrits refusés, une jeune éditrice ambitieuse découvre par le plus grand des hasards un chef-d’œuvre littéraire délaissé. Enthousiasmée par cette trouvaille inédite, elle décide de le publier. Le roman remporte très vite un franc succès… Mais son mystérieux auteur, Henri Pick, pizzaiolo de son état, n’aurait selon son épouse jamais écrit de livres ; pire, il n’était pas particulièrement féru de littérature. Un critique illustre, un brin sceptique, doute de la légitimité de l’auteur… Comment Henri Pick aurait-il eu le temps d’écrire un tel chef-d’œuvre entre deux fournées ? Avec l’aide inopinée de la fille de l’énigmatique auteur, le journaliste critique Jean-Michel Rouche enquêtera pour découvrir le fin mot de l’histoire, au risque de mettre en péril sa propre carrière tout comme sa réputation…
 Cette semaine, j’ai fait une petite sortie cinéma pour découvrir en salle le nouveau long métrage de Safy Nebbou, adapté du roman best-seller de Camille Laurens. La présence rayonnante à l’écran de Juliette Binoche, une actrice que j’admire grandement depuis sa performance bouleversante dans Le patient anglais, a incontestablement influencé mon souhait de visionner ce film d’auteur. J’ai par la suite acheté le roman pour le lire en parallèle et entrevoir l’œuvre profondément féministe de cette romancière philosophe qui avait fait couler tant d’encre lors de sa parution en 2016. Je vous l’avoue sans détour, j’ai été d’emblée conquise par ce roman à tiroirs, désespérant, mais pourtant résolument moderne d’une femme d’une cinquantaine d’années qui refuse de renoncer au désir qui la consume, dans une société impitoyable où l’image de la perfection et de l’éternelle jeunesse féminine priment sans cesse sur l’intellect. Refusant de faire face à l’abandon et au désespoir, l’héroïne, qui se dit « vieillissante », sombre ainsi dans une fiction illusoire qu’elle forge de toute pièce, à l’instar de son avatar sur Facebook. Professeur d’université de Lettres Modernes, mère de deux enfants et divorcée, elle crée un alter ego fictif sur internet afin d’espionner tout d’abord son ancien amant Jo qui l’a lâchement délaissée, mais finit par jeter son dévolu sur son colocataire. Dès lors, tissant une myriade de mensonges, elle deviendra Clara Antunès, une jolie brunette de vingt-quatre ans à la timidité attachante, stagiaire dans l’événementiel de la mode et rémunérée au lance-pierres. Ce piège en apparence odieux se refermera sur Chris, un jeune photographe un tantinet naïf qui succombera au charme diabolique de cette mystérieuse correspondante…
Cette semaine, j’ai fait une petite sortie cinéma pour découvrir en salle le nouveau long métrage de Safy Nebbou, adapté du roman best-seller de Camille Laurens. La présence rayonnante à l’écran de Juliette Binoche, une actrice que j’admire grandement depuis sa performance bouleversante dans Le patient anglais, a incontestablement influencé mon souhait de visionner ce film d’auteur. J’ai par la suite acheté le roman pour le lire en parallèle et entrevoir l’œuvre profondément féministe de cette romancière philosophe qui avait fait couler tant d’encre lors de sa parution en 2016. Je vous l’avoue sans détour, j’ai été d’emblée conquise par ce roman à tiroirs, désespérant, mais pourtant résolument moderne d’une femme d’une cinquantaine d’années qui refuse de renoncer au désir qui la consume, dans une société impitoyable où l’image de la perfection et de l’éternelle jeunesse féminine priment sans cesse sur l’intellect. Refusant de faire face à l’abandon et au désespoir, l’héroïne, qui se dit « vieillissante », sombre ainsi dans une fiction illusoire qu’elle forge de toute pièce, à l’instar de son avatar sur Facebook. Professeur d’université de Lettres Modernes, mère de deux enfants et divorcée, elle crée un alter ego fictif sur internet afin d’espionner tout d’abord son ancien amant Jo qui l’a lâchement délaissée, mais finit par jeter son dévolu sur son colocataire. Dès lors, tissant une myriade de mensonges, elle deviendra Clara Antunès, une jolie brunette de vingt-quatre ans à la timidité attachante, stagiaire dans l’événementiel de la mode et rémunérée au lance-pierres. Ce piège en apparence odieux se refermera sur Chris, un jeune photographe un tantinet naïf qui succombera au charme diabolique de cette mystérieuse correspondante…


 Il y a quelques jours une collègue de travail m’avait prêté ce roman d’initiation. Elle avait en effet dévoré ce « petit » livre, un roman d’apprentissage d’une jeune femme qui découvrait pour la première fois les affres de la passion à dix-huit ans. Nous avions échangé brièvement sur cette œuvre. L’histoire semblait rappeler étrangement
Il y a quelques jours une collègue de travail m’avait prêté ce roman d’initiation. Elle avait en effet dévoré ce « petit » livre, un roman d’apprentissage d’une jeune femme qui découvrait pour la première fois les affres de la passion à dix-huit ans. Nous avions échangé brièvement sur cette œuvre. L’histoire semblait rappeler étrangement  Après de nombreuses déceptions littéraires ces dernières semaines, mon engouement pour la lecture s’était sérieusement émoussé. Mais par le plus grand des hasards, en parcourant sans grande conviction les étalages d’une supérette du coin, je suis tombée sur ce roman grand format qui a tout de suite attiré mon œil scrutateur. La couverture était attrayante, l’illustration superbe, et le résumé du roman, un préquel de l’œuvre illustre et intemporelle de Bram Stocker, Dracula, franchement alléchant, comment résister à l’appel de la tentation ? Impossible dès lors de détacher mes yeux de ce livre pourtant onéreux. La littérature vampirique m’ayant toujours fascinée depuis mon plus jeune âge, j’ai donc acheté sans plus tarder ce roman intriguant. A ma grande surprise, ce fut une bonne pioche, car j’ai fait la découverte d’une petite pépite littéraire qui m’a séduite dès le premier chapitre. Une fois cette étape franchie, il m’était impossible de faire machine arrière. J’étais moi aussi ferrée par l’aura magnétique de Dracula… Qui ne l’est pas ? me direz-vous. Le mythe du vampire répulse autant qu’il fascine. Sommes-nous d’ailleurs attirés par son pouvoir d’immortalité qui nous renvoie à notre peur viscérale de mourir, la crainte inexorable de disparaître dans l’oubli, balayé par les vents comme une poussière insignifiante ? Ou bien sommes-nous tout simplement fascinés par ce personnage hautement romantique, de l’être déchu qui, tel Prométhée, aurait-été damné pour avoir osé défier l’autorité de son créateur suprême ? Quoiqu’il en soit… Il semble que le mythe du vampire demeure encore aujourd’hui une source d’inspiration intarissable pour les romanciers même contemporains.
Après de nombreuses déceptions littéraires ces dernières semaines, mon engouement pour la lecture s’était sérieusement émoussé. Mais par le plus grand des hasards, en parcourant sans grande conviction les étalages d’une supérette du coin, je suis tombée sur ce roman grand format qui a tout de suite attiré mon œil scrutateur. La couverture était attrayante, l’illustration superbe, et le résumé du roman, un préquel de l’œuvre illustre et intemporelle de Bram Stocker, Dracula, franchement alléchant, comment résister à l’appel de la tentation ? Impossible dès lors de détacher mes yeux de ce livre pourtant onéreux. La littérature vampirique m’ayant toujours fascinée depuis mon plus jeune âge, j’ai donc acheté sans plus tarder ce roman intriguant. A ma grande surprise, ce fut une bonne pioche, car j’ai fait la découverte d’une petite pépite littéraire qui m’a séduite dès le premier chapitre. Une fois cette étape franchie, il m’était impossible de faire machine arrière. J’étais moi aussi ferrée par l’aura magnétique de Dracula… Qui ne l’est pas ? me direz-vous. Le mythe du vampire répulse autant qu’il fascine. Sommes-nous d’ailleurs attirés par son pouvoir d’immortalité qui nous renvoie à notre peur viscérale de mourir, la crainte inexorable de disparaître dans l’oubli, balayé par les vents comme une poussière insignifiante ? Ou bien sommes-nous tout simplement fascinés par ce personnage hautement romantique, de l’être déchu qui, tel Prométhée, aurait-été damné pour avoir osé défier l’autorité de son créateur suprême ? Quoiqu’il en soit… Il semble que le mythe du vampire demeure encore aujourd’hui une source d’inspiration intarissable pour les romanciers même contemporains.
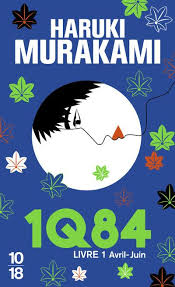 Pour ce timide retour, mon choix s’est porté sur une lecture japonaise plutôt insolite, qui, à mon sens, s’apparente davantage à un ovni littéraire, le livre semblant n’appartenir à aucune catégorie spécifique. Est-ce un roman réaliste, de science-fiction, d’amour ou même une dystopie ? Il semble que cette œuvre effleure tous ces genres littéraires sans néanmoins véritablement en respecter les codes. Le succès éditorial retentissant autour de cette trilogie m’intriguait ayant lu de nombreuses critiques élogieuses à son sujet, tant sur la toile que dans les revues littéraires. Il y a quelques années déjà, j’avais tenté d’explorer l’univers éparpillé de Murakami en lisant Au sud de la frontière, à l’ouest du soleil … Un roman dont je garde aujourd’hui un souvenir flou et un ressenti en demi-teinte. Il m’est d’ailleurs impossible de me remémorer clairement les tenants et aboutissants de l’intrigue pas plus que le nom ou les traits de caractère des personnages. C’est pour dire… Loin d’être un coup de cœur, j’étais restée de marbre face à la « virtuosité d’écriture » du romancier nippon tant décriée par la critique française enthousiaste. Qu’en est-il aujourd’hui ? L’alchimie a-t-elle cette fois-ci opéré ?
Pour ce timide retour, mon choix s’est porté sur une lecture japonaise plutôt insolite, qui, à mon sens, s’apparente davantage à un ovni littéraire, le livre semblant n’appartenir à aucune catégorie spécifique. Est-ce un roman réaliste, de science-fiction, d’amour ou même une dystopie ? Il semble que cette œuvre effleure tous ces genres littéraires sans néanmoins véritablement en respecter les codes. Le succès éditorial retentissant autour de cette trilogie m’intriguait ayant lu de nombreuses critiques élogieuses à son sujet, tant sur la toile que dans les revues littéraires. Il y a quelques années déjà, j’avais tenté d’explorer l’univers éparpillé de Murakami en lisant Au sud de la frontière, à l’ouest du soleil … Un roman dont je garde aujourd’hui un souvenir flou et un ressenti en demi-teinte. Il m’est d’ailleurs impossible de me remémorer clairement les tenants et aboutissants de l’intrigue pas plus que le nom ou les traits de caractère des personnages. C’est pour dire… Loin d’être un coup de cœur, j’étais restée de marbre face à la « virtuosité d’écriture » du romancier nippon tant décriée par la critique française enthousiaste. Qu’en est-il aujourd’hui ? L’alchimie a-t-elle cette fois-ci opéré ? Voilà une étrangeté littéraire qui me hantera sans-doute jusqu’à la fin de mes jours… Je l’avais dégotée durant une errance sans but dans une librairie de province. Quelle bonne pioche ! La couverture superbe de cette œuvre singulière m’avait d’emblée plu car elle me rappelait les peintures impressionnistes qui sont souvent associées dans mon imagination aux œuvres romantiques flamandes du XIXème siècle. Cette couverture évoque curieusement à mes yeux la nature luxuriante des alpes autrichiennes dépeinte dans Frankenstein de Mary Shelley, tout comme les paysages vallonnés décrits dans Les souffrances de Werther de Goethe. A l’instar des romantiques, la narratrice anonyme de ce roman se pâme elle aussi à la vue d’une forêt verdoyante, d’un lac ondulant, ou même d’éclairs déchirant un ciel orageux. Elle recherche par ailleurs la pureté d’une nature intouchée par l’Homme qui corrompt ou détruit tout ce qui est à sa portée sans se soucier des conséquences dramatiques pour son environnement. Est-ce là un message subtil d’une écrivaine féministe engagée qui en profite pour régler ses comptes avec l’espèce humaine ? Indubitablement, même si cette œuvre émouvante recèle quantités d’autres trésors de réflexions philosophiques propres à la condition humaine…
Voilà une étrangeté littéraire qui me hantera sans-doute jusqu’à la fin de mes jours… Je l’avais dégotée durant une errance sans but dans une librairie de province. Quelle bonne pioche ! La couverture superbe de cette œuvre singulière m’avait d’emblée plu car elle me rappelait les peintures impressionnistes qui sont souvent associées dans mon imagination aux œuvres romantiques flamandes du XIXème siècle. Cette couverture évoque curieusement à mes yeux la nature luxuriante des alpes autrichiennes dépeinte dans Frankenstein de Mary Shelley, tout comme les paysages vallonnés décrits dans Les souffrances de Werther de Goethe. A l’instar des romantiques, la narratrice anonyme de ce roman se pâme elle aussi à la vue d’une forêt verdoyante, d’un lac ondulant, ou même d’éclairs déchirant un ciel orageux. Elle recherche par ailleurs la pureté d’une nature intouchée par l’Homme qui corrompt ou détruit tout ce qui est à sa portée sans se soucier des conséquences dramatiques pour son environnement. Est-ce là un message subtil d’une écrivaine féministe engagée qui en profite pour régler ses comptes avec l’espèce humaine ? Indubitablement, même si cette œuvre émouvante recèle quantités d’autres trésors de réflexions philosophiques propres à la condition humaine…

 Voilà un livre qui n’aura pas fait long feu dans ma bibliothèque ! Dès sa première parution, cette petite fresque romanesque avait très vite connu un joli succès en librairie tout comme sur la blogosphère grâce, notamment, au triomphe de la série Dowtown Abbey qui a ouvert la voie à l’exploitation de sagas so British ! C’est pourquoi, je guettais sa sortie en poche avec une impatience non feinte. C’est chose faite ! Centenaire oblige, la Grande guerre suscite en ce moment un intérêt historique tout particulier pour nos auteurs contemporains qui exploitent régulièrement ce filon avec plus ou moins de panache. Helen Simonson ne déroge pas à la règle et nous transporte ici dans une époque révolue, celle de la Grande guerre (1914-1918).
Voilà un livre qui n’aura pas fait long feu dans ma bibliothèque ! Dès sa première parution, cette petite fresque romanesque avait très vite connu un joli succès en librairie tout comme sur la blogosphère grâce, notamment, au triomphe de la série Dowtown Abbey qui a ouvert la voie à l’exploitation de sagas so British ! C’est pourquoi, je guettais sa sortie en poche avec une impatience non feinte. C’est chose faite ! Centenaire oblige, la Grande guerre suscite en ce moment un intérêt historique tout particulier pour nos auteurs contemporains qui exploitent régulièrement ce filon avec plus ou moins de panache. Helen Simonson ne déroge pas à la règle et nous transporte ici dans une époque révolue, celle de la Grande guerre (1914-1918).
 En outre, l’auteur brosse le portrait peu flatteur mais tellement authentique de ces jeunes femmes de bonne famille qui, pour se désennuyer, attiraient dans leurs filets de jeunes soldats fraîchement enrôlés. L’une de ces figures féminines incarne à merveille ces jeunes filles britanniques formatées et pleine de bons sentiments qui contribueront par coquetterie et stupidité à pousser un grand nombre de soldats à servir comme chair à canon sur le front. Pour les convaincre de s’engager, ces évaporées vaniteuses les menacent en effet de leur offrir la fameuse plume blanche. Ce symbole traditionnel de lâcheté était une pratique très répandue sous l’Empire britannique qui inspira en 1902 A.E.W Mason pour donner vie à un roman d’aventure exceptionnel :
En outre, l’auteur brosse le portrait peu flatteur mais tellement authentique de ces jeunes femmes de bonne famille qui, pour se désennuyer, attiraient dans leurs filets de jeunes soldats fraîchement enrôlés. L’une de ces figures féminines incarne à merveille ces jeunes filles britanniques formatées et pleine de bons sentiments qui contribueront par coquetterie et stupidité à pousser un grand nombre de soldats à servir comme chair à canon sur le front. Pour les convaincre de s’engager, ces évaporées vaniteuses les menacent en effet de leur offrir la fameuse plume blanche. Ce symbole traditionnel de lâcheté était une pratique très répandue sous l’Empire britannique qui inspira en 1902 A.E.W Mason pour donner vie à un roman d’aventure exceptionnel : 
 Cette année, le festival de Saint-Maur en poche a une fois de plus ouvert ses portes pour nous faire découvrir de nouvelles œuvres et rencontrer des auteurs prometteurs encore « accessibles » au grand public. Etant tout deux férus de livres, mon père et moi avons décidé de partir ensemble à la découverte de cette vaste foire aux livres dont nous avions entendu tellement de bien sur la blogosphère et dans la presse. Nous avons quitté la Normandie hier soir et avons passé la nuit en région parisienne. Le lendemain matin nous attendions au pied levé l’ouverture du salon. Après dix minutes d’attente qui nous ont paru relativement brèves, nous avons promptement effectué un petit tour des lieux à la manière d’éclaireurs aguerris, préparant déjà mentalement notre future liste d’emplettes… Les lecteurs compulsifs que nous sommes ont dû faire face à une tentation des plus redoutables. Le choix fut rude et nous avons dû nous forcer, du fait d’un budget limité, à rester raisonnable. Un véritable crève-cœur pour moi ! Au final, je suis repartie avec quatre romans que je compte lire dès la semaine prochaine quand j’aurai terminé ma PAL du Mois anglais qui arrive presque à terme.
Cette année, le festival de Saint-Maur en poche a une fois de plus ouvert ses portes pour nous faire découvrir de nouvelles œuvres et rencontrer des auteurs prometteurs encore « accessibles » au grand public. Etant tout deux férus de livres, mon père et moi avons décidé de partir ensemble à la découverte de cette vaste foire aux livres dont nous avions entendu tellement de bien sur la blogosphère et dans la presse. Nous avons quitté la Normandie hier soir et avons passé la nuit en région parisienne. Le lendemain matin nous attendions au pied levé l’ouverture du salon. Après dix minutes d’attente qui nous ont paru relativement brèves, nous avons promptement effectué un petit tour des lieux à la manière d’éclaireurs aguerris, préparant déjà mentalement notre future liste d’emplettes… Les lecteurs compulsifs que nous sommes ont dû faire face à une tentation des plus redoutables. Le choix fut rude et nous avons dû nous forcer, du fait d’un budget limité, à rester raisonnable. Un véritable crève-cœur pour moi ! Au final, je suis repartie avec quatre romans que je compte lire dès la semaine prochaine quand j’aurai terminé ma PAL du Mois anglais qui arrive presque à terme. Cette petite escapade littéraire fut très bénéfique, car elle m’aura permis de faire également la rencontre du vlogger-libraire Gérard Collard qui gère la librairie La griffe noire, à Créteil, en région parisienne. J’ai été agréablement surprise de découvrir le chroniqueur très proche de ses lecteurs et franchement généreux, plutôt éloigné des libraires snobinards parisiens bobos qui ont, à mon sens, la fâcheuse tendance de vouloir détenir le monopole du bon goût et nous imposer leur choix de lectures souvent fadasses. Gérard Collard ne semble pas appartenir à ce microcosme suffisant. La provinciale que je suis a apprécié pouvoir ainsi voir au festival des auteurs venus des quatre coins du monde comme de nos régions. Nous avons pu échanger quelques mots avec le chroniqueur et suivi l’une des interviews organisées en directe du plateau de la chaîne Youtube La griffe noire, qui présentait aux lecteurs deux auteurs, Nadine Monfils et Hugo Buan, la première belge et le second français.
Cette petite escapade littéraire fut très bénéfique, car elle m’aura permis de faire également la rencontre du vlogger-libraire Gérard Collard qui gère la librairie La griffe noire, à Créteil, en région parisienne. J’ai été agréablement surprise de découvrir le chroniqueur très proche de ses lecteurs et franchement généreux, plutôt éloigné des libraires snobinards parisiens bobos qui ont, à mon sens, la fâcheuse tendance de vouloir détenir le monopole du bon goût et nous imposer leur choix de lectures souvent fadasses. Gérard Collard ne semble pas appartenir à ce microcosme suffisant. La provinciale que je suis a apprécié pouvoir ainsi voir au festival des auteurs venus des quatre coins du monde comme de nos régions. Nous avons pu échanger quelques mots avec le chroniqueur et suivi l’une des interviews organisées en directe du plateau de la chaîne Youtube La griffe noire, qui présentait aux lecteurs deux auteurs, Nadine Monfils et Hugo Buan, la première belge et le second français.


 Gladwyn a vraiment tout pour être heureux : une carrière qui semble plutôt prospère, une petite propriété coquette dans une banlieue paisible et huppée de la périphérie londonienne où il vit aux côtés de sa belle et tendre épouse Blythe et de son adolescent sans problème. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Aucun nuage à l’horizon. Gladwyn se laisse bercer par cette existence routinière sans embûche qui semble lui satisfaire.
Gladwyn a vraiment tout pour être heureux : une carrière qui semble plutôt prospère, une petite propriété coquette dans une banlieue paisible et huppée de la périphérie londonienne où il vit aux côtés de sa belle et tendre épouse Blythe et de son adolescent sans problème. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Aucun nuage à l’horizon. Gladwyn se laisse bercer par cette existence routinière sans embûche qui semble lui satisfaire.

 Pour cette deuxième contribution au challenge Le Mois anglais, mon choix s’est porté sur ce roman au contexte littéraire très victorien. J’ai été immédiatement attirée par cette magnifique couverture aux couleurs froides semblables à celles du givre en hiver, qui m’évoquent les paysages rustiques et pittoresques du milieu rural anglais dépeints avec virtuosité par les sœurs Brontë.
Pour cette deuxième contribution au challenge Le Mois anglais, mon choix s’est porté sur ce roman au contexte littéraire très victorien. J’ai été immédiatement attirée par cette magnifique couverture aux couleurs froides semblables à celles du givre en hiver, qui m’évoquent les paysages rustiques et pittoresques du milieu rural anglais dépeints avec virtuosité par les sœurs Brontë.



 Pour ouvrir le bal de cette sixième saison du
Pour ouvrir le bal de cette sixième saison du 




 Edith Waring, romancière en herbe incomprise de la petite bourgeoisie new-yorkaise du XIXème siècle, comble ses journées d’oisiveté en s’attelant à la rédaction de nouvelles fantastiques, des histoires frissonnantes de fantômes, qui ne trouvent malheureusement pas grâce auprès des maisons d’édition, plus friandes de littérature sentimentale, un style qui semble à son grand regret faire davantage fureur chez la gente féminine. La jeune femme, entêtée, aspire pourtant à gagner son indépendance en devenant une écrivaine illustre à l’instar de son principal modèle, Mary Shelley, pour qui elle voue une admiration fervente. Mais ses grands projets d’écriture – tout comme ceux de célibat – sont finalement chamboulés lorsqu’elle rencontre Thomas Sharpe, un séduisant aristocrate britannique sans le sou, au charme redoutable, pour lequel son cœur chavirera. Cette soudaine idylle ne plait guère au père de la jeune femme. Les mains délicates de ce noble personnage aux vêtements élimés ne lui inspirent que du mépris. Il n’apprécie pas non plus sa sœur, Lady Lucille, une pianiste virtuose qui l’accompagne à chacun de ses déplacements. A la mort subite de son père, Edith prendra une décision irrévocable qui bouleversera à jamais sa destinée : celle d’épouser Thomas Sharpe malgré les avertissements de son entourage et de s’embarquer avec lui pour la vieille Europe. Là-bas, en Angleterre, l’attend la demeure familiale délabrée des Sharpe, Crimson Peak, un manoir vétuste, juché au milieu de terres arides qui semblent abriter de terribles secrets. Que dissimulent vraiment ses murs pourris par l’humidité et le passage impitoyable du temps ? Edith le découvrira bien vite à ses propres dépens…
Edith Waring, romancière en herbe incomprise de la petite bourgeoisie new-yorkaise du XIXème siècle, comble ses journées d’oisiveté en s’attelant à la rédaction de nouvelles fantastiques, des histoires frissonnantes de fantômes, qui ne trouvent malheureusement pas grâce auprès des maisons d’édition, plus friandes de littérature sentimentale, un style qui semble à son grand regret faire davantage fureur chez la gente féminine. La jeune femme, entêtée, aspire pourtant à gagner son indépendance en devenant une écrivaine illustre à l’instar de son principal modèle, Mary Shelley, pour qui elle voue une admiration fervente. Mais ses grands projets d’écriture – tout comme ceux de célibat – sont finalement chamboulés lorsqu’elle rencontre Thomas Sharpe, un séduisant aristocrate britannique sans le sou, au charme redoutable, pour lequel son cœur chavirera. Cette soudaine idylle ne plait guère au père de la jeune femme. Les mains délicates de ce noble personnage aux vêtements élimés ne lui inspirent que du mépris. Il n’apprécie pas non plus sa sœur, Lady Lucille, une pianiste virtuose qui l’accompagne à chacun de ses déplacements. A la mort subite de son père, Edith prendra une décision irrévocable qui bouleversera à jamais sa destinée : celle d’épouser Thomas Sharpe malgré les avertissements de son entourage et de s’embarquer avec lui pour la vieille Europe. Là-bas, en Angleterre, l’attend la demeure familiale délabrée des Sharpe, Crimson Peak, un manoir vétuste, juché au milieu de terres arides qui semblent abriter de terribles secrets. Que dissimulent vraiment ses murs pourris par l’humidité et le passage impitoyable du temps ? Edith le découvrira bien vite à ses propres dépens…


 Jack Torrance, ancien alcoolique et professeur de Lettres raté, accepte un poste de gardien à L’Overlook Hotel, un établissement de luxe à la réputation sulfureuse qui domine les montagnes escarpées d’une petite bourgade isolée du Colorado. Les portes de ce palace mystérieux restent closes l’hiver. Le froid mordant et la neige épaisse dissuadant les touristes de passages de s’aventurer sur les routes accidentées, l’endroit est déserté pendant plusieurs mois de l’année. Jack accompagné de son épouse Wendy et de son jeune fils Danny, pense y trouver une retraite idéale tout comme un refuge pour s’adonner à ses projets d’écriture et renouer avec sa famille. Mais cette bulle de quiétude sera très vite bouleversée à la suite de manifestations surnaturelles pour le moins inquiétantes…
Jack Torrance, ancien alcoolique et professeur de Lettres raté, accepte un poste de gardien à L’Overlook Hotel, un établissement de luxe à la réputation sulfureuse qui domine les montagnes escarpées d’une petite bourgade isolée du Colorado. Les portes de ce palace mystérieux restent closes l’hiver. Le froid mordant et la neige épaisse dissuadant les touristes de passages de s’aventurer sur les routes accidentées, l’endroit est déserté pendant plusieurs mois de l’année. Jack accompagné de son épouse Wendy et de son jeune fils Danny, pense y trouver une retraite idéale tout comme un refuge pour s’adonner à ses projets d’écriture et renouer avec sa famille. Mais cette bulle de quiétude sera très vite bouleversée à la suite de manifestations surnaturelles pour le moins inquiétantes…

 L’auteur a ainsi un talent indéniable pour nous mettre mal à l’aise. L’histoire étant perçue à travers le prisme du regard d’un petit garçon aux dons de médium, maltraité par un père imprévisible, elle n’en devient que plus effrayante. Stephen King qui souhaitait désespérément égaler la plume acide de Richard Matheson, un écrivain américain de science-fiction et de littérature fantastique angoissante, surpasse finalement son modèle en restituant une atmosphère plus terrifiante. J’ai voulu cette fois-ci faire d’une pierre deux coups en lisant également cet écrivain incontournable du genre, auteur du best-seller Je suis une légende, pour entrevoir un peu plus son univers. A mon grand regret, j’ai trouvé que La maison des damnés, l’œuvre dans laquelle Stephen King a puisé sa principale source d’inspiration, faisait plutôt pâle figure face à Shining qui est plus abouti. Il est de surcroît difficile de ne pas établir un lien entre ces deux romans, les similitudes étant trop flagrantes. De ce fait, la demeure maléfique chargée d’un passé douteux de l’Overlook Hotel n’est pas sans rappeler la maison Belasco qui abrite aussi des esprits malfaisants. Ces deux établissements auréolés de scandale auraient tous deux été la propriété de gangsters. Ces détails expliquant le passé tourmenté de ces lieux hantés par le Mal, sont repris avec plus d’habileté dans Shining.
L’auteur a ainsi un talent indéniable pour nous mettre mal à l’aise. L’histoire étant perçue à travers le prisme du regard d’un petit garçon aux dons de médium, maltraité par un père imprévisible, elle n’en devient que plus effrayante. Stephen King qui souhaitait désespérément égaler la plume acide de Richard Matheson, un écrivain américain de science-fiction et de littérature fantastique angoissante, surpasse finalement son modèle en restituant une atmosphère plus terrifiante. J’ai voulu cette fois-ci faire d’une pierre deux coups en lisant également cet écrivain incontournable du genre, auteur du best-seller Je suis une légende, pour entrevoir un peu plus son univers. A mon grand regret, j’ai trouvé que La maison des damnés, l’œuvre dans laquelle Stephen King a puisé sa principale source d’inspiration, faisait plutôt pâle figure face à Shining qui est plus abouti. Il est de surcroît difficile de ne pas établir un lien entre ces deux romans, les similitudes étant trop flagrantes. De ce fait, la demeure maléfique chargée d’un passé douteux de l’Overlook Hotel n’est pas sans rappeler la maison Belasco qui abrite aussi des esprits malfaisants. Ces deux établissements auréolés de scandale auraient tous deux été la propriété de gangsters. Ces détails expliquant le passé tourmenté de ces lieux hantés par le Mal, sont repris avec plus d’habileté dans Shining.
 Une fois n’est pas coutume, je souhaitais faire une petite parenthèse légère au « Challenge Halloween » pour partager avec vous ma passion pour les bibliothèques. Je possède une grande collection de livres. Depuis notre installation dans notre nouvelle demeure, j’ai dû investir dans quelques meubles d’appoint pour contenir toute ma pile de livres qui s’alourdie un peu plus chaque mois. J’aime beaucoup les étagères blanches « Shabby chic », un style très british dont je raffole particulièrement. Je flâne d’ailleurs régulièrement dans les boutiques de Maisons du monde pour puiser mon inspiration lorsque je décore mon intérieur. Malheureusement, les meubles en bois de cette enseigne sont bien souvent trop onéreux pour mon modeste budget. Mais qu’à cela ne tienne ! J’essaie toujours de chercher des bons plans pour décorer sans trop me ruiner. Mon tendre m’a offert récemment un meuble magnifique bien rustique, blanc de surcroît, que nous avons dégoté… chez Ikea. Nous avons décidé ensemble de le customiser pour rendre son aspect plus vieillot et authentique. Si notre idée d’ajouter une petite touche colorée au meuble pour lui donner plus de cachet semblait en soi être au départ une bonne idée, l’entreprise s’est finalement révélée complexe. Le papier peint que nous avions choisi n’adhérait d’abord pas correctement au bois et il se gondolait et se décollait par certains endroits, une vraie catastrophe ! Il nous aura fallu nous armer de beaucoup de courage tout comme de patience pour pouvoir mettre cette bibliothèque enfin sur pieds, une tâche fastidieuse à laquelle nous avons consacré plusieurs soirées d’affilée. Alors que j’étais sur le point de baisser définitivement les bras, mon tendre m’a fait la surprise cette après-midi de finaliser seul le travail. L’attente en valait la peine, je suis aux anges ! Le meuble me plait grandement et a déjà pris ses marques dans mon boudoir. Le résultat n’est-il pas bluffant ?
Une fois n’est pas coutume, je souhaitais faire une petite parenthèse légère au « Challenge Halloween » pour partager avec vous ma passion pour les bibliothèques. Je possède une grande collection de livres. Depuis notre installation dans notre nouvelle demeure, j’ai dû investir dans quelques meubles d’appoint pour contenir toute ma pile de livres qui s’alourdie un peu plus chaque mois. J’aime beaucoup les étagères blanches « Shabby chic », un style très british dont je raffole particulièrement. Je flâne d’ailleurs régulièrement dans les boutiques de Maisons du monde pour puiser mon inspiration lorsque je décore mon intérieur. Malheureusement, les meubles en bois de cette enseigne sont bien souvent trop onéreux pour mon modeste budget. Mais qu’à cela ne tienne ! J’essaie toujours de chercher des bons plans pour décorer sans trop me ruiner. Mon tendre m’a offert récemment un meuble magnifique bien rustique, blanc de surcroît, que nous avons dégoté… chez Ikea. Nous avons décidé ensemble de le customiser pour rendre son aspect plus vieillot et authentique. Si notre idée d’ajouter une petite touche colorée au meuble pour lui donner plus de cachet semblait en soi être au départ une bonne idée, l’entreprise s’est finalement révélée complexe. Le papier peint que nous avions choisi n’adhérait d’abord pas correctement au bois et il se gondolait et se décollait par certains endroits, une vraie catastrophe ! Il nous aura fallu nous armer de beaucoup de courage tout comme de patience pour pouvoir mettre cette bibliothèque enfin sur pieds, une tâche fastidieuse à laquelle nous avons consacré plusieurs soirées d’affilée. Alors que j’étais sur le point de baisser définitivement les bras, mon tendre m’a fait la surprise cette après-midi de finaliser seul le travail. L’attente en valait la peine, je suis aux anges ! Le meuble me plait grandement et a déjà pris ses marques dans mon boudoir. Le résultat n’est-il pas bluffant ?

 Margaret Léa, bouquiniste et biographe à ses heures perdues, reçoit une lettre mystérieuse de Vida Winter, une romancière au succès planétaire qui aurait publié plus d’une centaine de best-sellers. Cette dame âgée et souffrante la sollicite pour écrire ses ultimes mémoires et lever le voile sur sa dernière œuvre inachevée, Le treizième conte. Elle souhaite enfin révéler la vérité sur son passé dont elle a souvent donné des versions trop édulcorées à la presse. Margaret, intriguée par la personnalité insolite de cette auteure prolifique accepte finalement cette requête ambitieuse. Mais en écoutant le récit fantasque de l’écrivaine, elle commence à douter de la véracité des faits : se peut-il qu’une fois de plus Vida Winter mente sur ses origines?
Margaret Léa, bouquiniste et biographe à ses heures perdues, reçoit une lettre mystérieuse de Vida Winter, une romancière au succès planétaire qui aurait publié plus d’une centaine de best-sellers. Cette dame âgée et souffrante la sollicite pour écrire ses ultimes mémoires et lever le voile sur sa dernière œuvre inachevée, Le treizième conte. Elle souhaite enfin révéler la vérité sur son passé dont elle a souvent donné des versions trop édulcorées à la presse. Margaret, intriguée par la personnalité insolite de cette auteure prolifique accepte finalement cette requête ambitieuse. Mais en écoutant le récit fantasque de l’écrivaine, elle commence à douter de la véracité des faits : se peut-il qu’une fois de plus Vida Winter mente sur ses origines?



 Je viens tout juste d’achever ce court roman percutant d’Henry James, maître incontestable de la nouvelle au XIXème siècle. Souvenez-vous, il y a un an déjà je vous parlais avec passion du
Je viens tout juste d’achever ce court roman percutant d’Henry James, maître incontestable de la nouvelle au XIXème siècle. Souvenez-vous, il y a un an déjà je vous parlais avec passion du 

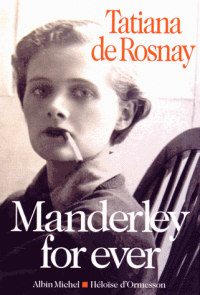 Pour notre plus grand bonheur cette année, Tatiana de Rosnay s’est lancée sur les traces de Daphne du Maurier, une initiative que je ne peux que saluer étant une fervente admiratrice de cette romancière anglaise prolifique. J’avais en effet découvert avec émerveillement son talent exceptionnel durant mon adolescence. Je garde encore un souvenir impérissable de Rebecca et de Ma cousine Rachel tout comme de Jamaïca Inn. Passionnée par sa vie tout comme son œuvre foisonnante (pas moins de 15 romans, six recueils de nouvelles et j’en passe), je m’étais rendue, il y a quelques années à la manière d’un pèlerin, à Bodmin en Cornouailles pour visiter « L’auberge de la Jamaïque » où un musée remarquable lui est entièrement consacré. Bien entendu, lorsque j’ai appris la parution de cette biographie à la couverture sublime, je n’ai pas hésité à l’ajouter à ma liste d’envie, espérant pouvoir l’acquérir dès que mon porte-monnaie me le permettrait. Finalement, ce sont mes parents qui me l’ont généreusement offert à l’occasion de mon anniversaire.
Pour notre plus grand bonheur cette année, Tatiana de Rosnay s’est lancée sur les traces de Daphne du Maurier, une initiative que je ne peux que saluer étant une fervente admiratrice de cette romancière anglaise prolifique. J’avais en effet découvert avec émerveillement son talent exceptionnel durant mon adolescence. Je garde encore un souvenir impérissable de Rebecca et de Ma cousine Rachel tout comme de Jamaïca Inn. Passionnée par sa vie tout comme son œuvre foisonnante (pas moins de 15 romans, six recueils de nouvelles et j’en passe), je m’étais rendue, il y a quelques années à la manière d’un pèlerin, à Bodmin en Cornouailles pour visiter « L’auberge de la Jamaïque » où un musée remarquable lui est entièrement consacré. Bien entendu, lorsque j’ai appris la parution de cette biographie à la couverture sublime, je n’ai pas hésité à l’ajouter à ma liste d’envie, espérant pouvoir l’acquérir dès que mon porte-monnaie me le permettrait. Finalement, ce sont mes parents qui me l’ont généreusement offert à l’occasion de mon anniversaire.






