Il y a quelques jours, M6 battait son record historique d’audience en une soirée, en diffusant à l’occasion des vacances de la Toussaint, Coco. Si je n’étais pas de la partie, ayant loupé le coche, je me suis très vite rattrapée le lendemain, en profitant du replay. D’après Le Figaro, ce petit bijou aurait réuni plus de 4 415 000 téléspectateurs en une seule soirée !
J’avais visionné ce film d’animation produit par les studios Disney Pixar à sa sortie en salle en 2017, et en gardais un souvenir mémorable ! Comme j’ai pleuré ! Evidemment, la magie a une fois de plus opérée. Je ne sais si l’ambiance morne du confinement, ou les perspectives floues de l’avenir, ont contribuées à mon ressenti, ou qui sait? Parce que je l’ai revu à présent à travers mes yeux de jeune maman, mais ce film m’a cette fois-ci davantage bouleversée. Coco est incontestablement un grand coup de cœur. D’où lui vient-donc cette popularité phénoménale qui perdure et s’intensifie au fil des années ?
Le message d’amour universel du film est sans doute l’une des principales clés de son succès. Si l’histoire prend pour toile de fond, la fête mexicaine des morts qui, d’ailleurs concorde avec le calendrier chrétien de la Toussaint (entre le 1er et le 2 novembre), elle relate avant tout l’importance de préserver la mémoire des ancêtres. Ainsi, le noyau familial semble être encore l’ultime rempart face aux innombrables détresses de notre vie sur terre, une existence oh combien brève et éphémère ! Ce message fait d’ailleurs étrangement écho à notre situation actuelle.
Miguel est un jeune garçon plein de fougue qui souhaiterait s’écarter du chemin tout tracé que lui réserve les siens. Il n’a aucunement envie de rejoindre l’entreprise familiale de souliers et ne rêve que d’une chose, devenir tout comme Ernesto de la Cruz, son idole, un grand musicien. Malheureusement, pour des raisons obscures, son entourage a banni la musique de sa vie… Un véritable crève-cœur pour Miguel. Ce dernier, décide donc de prendre la poudre d’escampette et de participer à un concert de guitare pour prouver son talent. Par un étrange concours de circonstances, il se retrouve propulsé au Pays des morts, un endroit fabuleux autant qu’inquiétant… Je n’en dirais pas plus au risque de gâcher tout le plaisir de la découverte de cette petite pépite, un film d’animation riche en émotion et à l’intrigue étonnement dense.
En visionnant une seconde fois Coco, j’ai d’ailleurs, à ma grande surprise réalisé que le titre de ce film d’animation n’était pas une référence au héros principal mais, à celui de son arrière-grand-mère. Ce long-métrage, par ailleurs, fourmille de belles scènes, à la fois drôles et attendrissantes. Je n’oublierai jamais ainsi, le passage de la chanson « remember me » (attention prévoyez une boîte de kleenex!) où Coco, vieille dame en déclin, se remémore les années de bonheurs insouciants qu’elle avait fugitivement passé auprès de son père, disparu trop tôt, alors qu’elle n’était encore qu’une toute petite fille. Rien que d’y penser, j’en ai les larmes aux yeux. Pixar a le chic pour nous toucher jusqu’aux tripes. On en ressort secoué mais grandi.

Si l’histoire est en effet profondément bouleversante, elle déborde néanmoins d’optimisme. En outre, Coco nous rappelle qu’il faut profiter pleinement de chaque instant passé en famille. Les souvenirs que nous gardons de ces précieux moments, qu’ils soient tristes ou joyeux, sont le sel de notre existence. Cette histoire touchante nous rappelle aussi que nous sommes tous le produit de nos ancêtres, ils vivent ainsi en nous et à travers nous.
Bien que la fête des morts au Mexique soit une célébration un tantinet morbide, elle reste néanmoins paradoxalement très joyeuse, et rime avec costumes colorés et musiques endiablées. Cette célébration permet aux vivants d’honorer ses disparus sans sombrer dans la mélancolie. Coco restitue à merveille cette ambiance étrange et troublante. Chaque année, durant cette saison, les mexicains envahissent leurs cimetières pour apporter des offrandes à leurs morts. Des objets personnels sont également déposés sur les tombes pour vénérer la mémoire de ces défunts. Cette tradition ancestrale, sous l’influence de la culture américaine et en particulier d’Halloween, a désormais évolué. Les enfants tout comme les adultes revêtent à présent eux-aussi des costumes effrayants pour défiler dans les rues… Peut-être un jour aurais-je l’occasion de voir de mes propres yeux cette fascinante coutume… J’en rêve !

En bref : Coco, est un long-métrage sublime sur la mémoire et un hommage vibrant à la culture mexicaine. Le graphisme des animations est soigné et les couleurs sont somptueuses. Ne vous fiez pas à son titre gentillet, cette œuvre est un petit joyau ! Voilà donc la magie des studios Disney Pixar, nous émerveiller encore et toujours ! Leur pouvoir transcende les âges, personne n’y est insensible. A voir sans modération !
Petite contribution au Mois Halloween et au Pumpkin Autumn Challenge (catégorie Automne douceur de vivre: Il fait un temps épouvantail!)

 A la veille de son seizième anniversaire, Sabrina Spellman, une jeune fille, doit prendre une décision importante, elle doit en effet choisir entre mener une vie paisible de mortelle avec son petit ami et ses camarades de lycée ou, embrasser la destinée exceptionnelle d’apprentie sorcière que lui réserve sa famille depuis sa naissance.
A la veille de son seizième anniversaire, Sabrina Spellman, une jeune fille, doit prendre une décision importante, elle doit en effet choisir entre mener une vie paisible de mortelle avec son petit ami et ses camarades de lycée ou, embrasser la destinée exceptionnelle d’apprentie sorcière que lui réserve sa famille depuis sa naissance.
 En bref : un Comics original qui flirte avec l’épouvante et l’univers rock des vieilles B.D vintage, dont je n’ai fait qu’une bouchée et que j’ai savouré comme une délicieuse friandise d’Halloween. Si ma passion va principalement à la lecture de romans, j’avoue malgré tout mon petit plaisir coupable pour les Comics. Les Nouvelles aventures de Sabrina a été pour moi un régal ! J’ai désormais hâte de lire la suite qui n’est pour le moment pas encore annoncée… En attendant, j’ai commandé pour Noël, Afterlife, une histoire Zombiesque dans la même collection et un petit hommage à l’œuvre Loftcraftienne tout comme à l’humour morbide et toqué des films de Sam Raimi (comment ne pas penser à Evil Dead en jetant un œil à la couverture ?!).
En bref : un Comics original qui flirte avec l’épouvante et l’univers rock des vieilles B.D vintage, dont je n’ai fait qu’une bouchée et que j’ai savouré comme une délicieuse friandise d’Halloween. Si ma passion va principalement à la lecture de romans, j’avoue malgré tout mon petit plaisir coupable pour les Comics. Les Nouvelles aventures de Sabrina a été pour moi un régal ! J’ai désormais hâte de lire la suite qui n’est pour le moment pas encore annoncée… En attendant, j’ai commandé pour Noël, Afterlife, une histoire Zombiesque dans la même collection et un petit hommage à l’œuvre Loftcraftienne tout comme à l’humour morbide et toqué des films de Sam Raimi (comment ne pas penser à Evil Dead en jetant un œil à la couverture ?!). Ce roman graphique est une petite bluette. L’histoire prend pour toile de fond la période d’Halloween. Toutefois, pas d’horreur ici, aucune présence spectrale ni monstrueuse dans cette intrigue somme toute assez simpliste : chaque automne, deux lycéens se retrouvent pour travailler au « Best pumpkin patch », un parc d’attraction à thème qui propose de nombreuses activités liées à la récolte de citrouilles… Cette saison se révèle bien différente des précédentes puisque les deux jeunes gens terminent enfin leur mission. L’année suivante, ils rentreront à l’université et devront stopper leur petit job d’étudiants. Josiah mélancolique, regrette de ne pas avoir avoué sa flamme à la ravissante « Fudge girl », une collègue de travail toujours débordée qu’il admire à distance depuis ses débuts au parc… Deja, quant à elle, n’a pas l’intention de laisser s’envoler l’opportunité de profiter pleinement de cet endroit fantastique avant son départ, c’est pourquoi elle propose à Josiah d’emprunter exceptionnellement le chemin de l’école buissonnière… Les deux camarades se lancent alors dans une quête insensée pour retrouver la mystérieuse « fudge girl » …
Ce roman graphique est une petite bluette. L’histoire prend pour toile de fond la période d’Halloween. Toutefois, pas d’horreur ici, aucune présence spectrale ni monstrueuse dans cette intrigue somme toute assez simpliste : chaque automne, deux lycéens se retrouvent pour travailler au « Best pumpkin patch », un parc d’attraction à thème qui propose de nombreuses activités liées à la récolte de citrouilles… Cette saison se révèle bien différente des précédentes puisque les deux jeunes gens terminent enfin leur mission. L’année suivante, ils rentreront à l’université et devront stopper leur petit job d’étudiants. Josiah mélancolique, regrette de ne pas avoir avoué sa flamme à la ravissante « Fudge girl », une collègue de travail toujours débordée qu’il admire à distance depuis ses débuts au parc… Deja, quant à elle, n’a pas l’intention de laisser s’envoler l’opportunité de profiter pleinement de cet endroit fantastique avant son départ, c’est pourquoi elle propose à Josiah d’emprunter exceptionnellement le chemin de l’école buissonnière… Les deux camarades se lancent alors dans une quête insensée pour retrouver la mystérieuse « fudge girl » …

 Le Mois Halloween arrive bientôt à sa fin… A l’annonce du reconfinement et pour chasser les idées noires, cette année, point de films d’horreurs pour nous ; nous avons préféré opter pour des films tout en légèreté et essentiellement destinés à être vus en famille, des histoires fantastiques qui font gentiment frissonner sans toutefois sombrer dans l’épouvante. Bref, des films « plaisir » pour se vider la tête et se déconnecter de ce monde déjà suffisamment sombre et inquiétant. Dans cette optique,
Le Mois Halloween arrive bientôt à sa fin… A l’annonce du reconfinement et pour chasser les idées noires, cette année, point de films d’horreurs pour nous ; nous avons préféré opter pour des films tout en légèreté et essentiellement destinés à être vus en famille, des histoires fantastiques qui font gentiment frissonner sans toutefois sombrer dans l’épouvante. Bref, des films « plaisir » pour se vider la tête et se déconnecter de ce monde déjà suffisamment sombre et inquiétant. Dans cette optique,  Cette nouvelle adaptation du livre pour enfant de Roald Dahl par Zemekis, l’excellent réalisateur de Retour vers le futur, relate le destin hors du commun de Bruno, un petit orphelin recueilli par sa grand-mère. Le film s’écarte de l’intrigue originale du roman en plantant son décor dans les années 60 en Alabama. Ainsi, ce choix de temporalité et de décor apporte une certaine touche d’originalité et de renouveau à l’œuvre quelque peu poussiéreuse de Roald Dahl. L’idée de transposer l’histoire de l’Angleterre au sud des Etats-Unis était de prime abord une belle trouvaille et permettait à l’actrice Octavia Spencer de briller dans son registre. Elle incarne une grand-mère énigmatique que l’on soupçonne de tremper elle aussi dans la sorcellerie… Disons-le franchement, tout comme dans La couleur des sentiments, l’actrice crève l’écran et cabotine ici à merveille ! Elle ne déçoit pas. C’était sans-doute le personnage le plus intéressant du film.
Cette nouvelle adaptation du livre pour enfant de Roald Dahl par Zemekis, l’excellent réalisateur de Retour vers le futur, relate le destin hors du commun de Bruno, un petit orphelin recueilli par sa grand-mère. Le film s’écarte de l’intrigue originale du roman en plantant son décor dans les années 60 en Alabama. Ainsi, ce choix de temporalité et de décor apporte une certaine touche d’originalité et de renouveau à l’œuvre quelque peu poussiéreuse de Roald Dahl. L’idée de transposer l’histoire de l’Angleterre au sud des Etats-Unis était de prime abord une belle trouvaille et permettait à l’actrice Octavia Spencer de briller dans son registre. Elle incarne une grand-mère énigmatique que l’on soupçonne de tremper elle aussi dans la sorcellerie… Disons-le franchement, tout comme dans La couleur des sentiments, l’actrice crève l’écran et cabotine ici à merveille ! Elle ne déçoit pas. C’était sans-doute le personnage le plus intéressant du film. The craft legacy, les nouvelles sorcières est, à la grande surprise générale, non un remake, mais bien une suite à The Craft (traduit sous le titre de Dangereuses alliances en français), un film sorti en 1996 : Hannah, une jeune fille réservée et introvertie débarque dans un nouveau lycée. Elle fait la connaissance de trois jeunes filles étranges qui prétendent être des sorcières. Séduite par leurs excentricités, Hannah découvre avec elles la pratique de la sorcellerie et tente de transformer ses rêves en réalité…
The craft legacy, les nouvelles sorcières est, à la grande surprise générale, non un remake, mais bien une suite à The Craft (traduit sous le titre de Dangereuses alliances en français), un film sorti en 1996 : Hannah, une jeune fille réservée et introvertie débarque dans un nouveau lycée. Elle fait la connaissance de trois jeunes filles étranges qui prétendent être des sorcières. Séduite par leurs excentricités, Hannah découvre avec elles la pratique de la sorcellerie et tente de transformer ses rêves en réalité… L’intérêt de The craft, en comparaison de The craft legacy, résidait dans la relation ambiguë qui liait les quatre adolescentes. Elles n’entretenaient pas à proprement parler une véritable amitié mais davantage une relation opportuniste. Les quatre filles à la fois complices et rivales ne pouvaient accéder à leurs dons que si elles maintenaient au sein du groupe une certaine unité qui chancelle inévitablement à mesure que leur soif de pouvoir grandit… Cette relation étrange et franchement malsaine était très bien exprimée. Toutefois le « génie » s’arrête là. Ce petit film de série B n’a d’ailleurs pas particulièrement bien vieilli même s’il reste encore culte.
L’intérêt de The craft, en comparaison de The craft legacy, résidait dans la relation ambiguë qui liait les quatre adolescentes. Elles n’entretenaient pas à proprement parler une véritable amitié mais davantage une relation opportuniste. Les quatre filles à la fois complices et rivales ne pouvaient accéder à leurs dons que si elles maintenaient au sein du groupe une certaine unité qui chancelle inévitablement à mesure que leur soif de pouvoir grandit… Cette relation étrange et franchement malsaine était très bien exprimée. Toutefois le « génie » s’arrête là. Ce petit film de série B n’a d’ailleurs pas particulièrement bien vieilli même s’il reste encore culte.


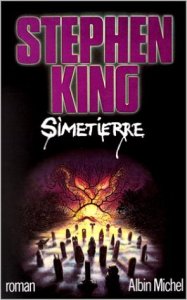 Le mois Halloween sans Stephen King, c’est comme célébrer Noël sans sapin ! C’est impossible… C’est pourquoi j’ai une fois de plus exhumé de ma PAL un nouveau titre de son œuvre prolifique.
Le mois Halloween sans Stephen King, c’est comme célébrer Noël sans sapin ! C’est impossible… C’est pourquoi j’ai une fois de plus exhumé de ma PAL un nouveau titre de son œuvre prolifique.  Les récits de Stephen King ont tous cette étrange particularité de nous chambouler, sans-doute parce que ses personnages sont souvent des êtres ordinaires, confrontés à des préoccupations bien triviales, ce qui renforce un peu plus le réalisme du décor. Ces personnages profondément humains sont toutefois capables du pire comme du meilleur… Rares sont les romanciers qui réussissent à décrire avec tant de finesse psychologique la violence sous jacente de la culture américaine, qui, rappelons-le, s’est tout de même bâtie sur du sang. Bercées dans cette culture, les œuvres de Stephen King reflètent l’Amérique profonde, une Amérique sombre et imprévisible.
Les récits de Stephen King ont tous cette étrange particularité de nous chambouler, sans-doute parce que ses personnages sont souvent des êtres ordinaires, confrontés à des préoccupations bien triviales, ce qui renforce un peu plus le réalisme du décor. Ces personnages profondément humains sont toutefois capables du pire comme du meilleur… Rares sont les romanciers qui réussissent à décrire avec tant de finesse psychologique la violence sous jacente de la culture américaine, qui, rappelons-le, s’est tout de même bâtie sur du sang. Bercées dans cette culture, les œuvres de Stephen King reflètent l’Amérique profonde, une Amérique sombre et imprévisible. Et l’adaptation dans tout ça ?
Et l’adaptation dans tout ça ?
 L’automne est sans aucun doute l’une de mes saisons favorites, j’aime les tons ocres qui habillent les feuilles des arbres en Normandie, la brume du matin qui plane au-dessus de l’herbe humide de rosée. Les jours se raccourcissent peu à peu et j’ai ainsi pu reprendre mes vieilles habitudes : les petites lectures tout comme les longues soirées/télé au coin du feu sous un plaid, entourée de mes chiens et chats, une tasse fumante de thé à mes côtés.
L’automne est sans aucun doute l’une de mes saisons favorites, j’aime les tons ocres qui habillent les feuilles des arbres en Normandie, la brume du matin qui plane au-dessus de l’herbe humide de rosée. Les jours se raccourcissent peu à peu et j’ai ainsi pu reprendre mes vieilles habitudes : les petites lectures tout comme les longues soirées/télé au coin du feu sous un plaid, entourée de mes chiens et chats, une tasse fumante de thé à mes côtés.






 La série
La série  Après le meurtre effroyable et brutal de leur père, la fratrie Locke découvre son nouveau foyer, le manoir étrange et ensorcelant de Keyhouse. Établie en Nouvelle-Angleterre à Lovecraft, cette demeure ancestrale, aux couloirs sinueux et aux multiples portes, semble un endroit rêvé pour panser ses plaies et retrouver un semblant d’équilibre. Malheureusement, cette bâtisse en apparence paisible se révèle hantée par une étrange créature qui rôde tapie dans l’ombre, attendant patiemment de trouver une clé, celle qui la libérera et lui permettra enfin d’ouvrir la plus terrifiante des portes du manoir… Qui est cette mystérieuse entité qui semble habitée le puits de cette propriété défraîchie ? Et quels sombres secrets dissimulent vraiment Keyhouse ?
Après le meurtre effroyable et brutal de leur père, la fratrie Locke découvre son nouveau foyer, le manoir étrange et ensorcelant de Keyhouse. Établie en Nouvelle-Angleterre à Lovecraft, cette demeure ancestrale, aux couloirs sinueux et aux multiples portes, semble un endroit rêvé pour panser ses plaies et retrouver un semblant d’équilibre. Malheureusement, cette bâtisse en apparence paisible se révèle hantée par une étrange créature qui rôde tapie dans l’ombre, attendant patiemment de trouver une clé, celle qui la libérera et lui permettra enfin d’ouvrir la plus terrifiante des portes du manoir… Qui est cette mystérieuse entité qui semble habitée le puits de cette propriété défraîchie ? Et quels sombres secrets dissimulent vraiment Keyhouse ?
 Il faut bien l’avouer, Joe Hill s’y connait pour ferrer son lecteur. Si le graphisme de Gabriel Rodriguez est particulièrement soigné, c’est l’écriture rythmée de l’auteur qui m’a d’emblée séduite. Joe Hill jongle inlassablement avec les codes du fantastique, du gothique et de l’horreur qu’il maîtrise d’ailleurs avec brio. Il apporte à l’ensemble un suspense haletant.
Il faut bien l’avouer, Joe Hill s’y connait pour ferrer son lecteur. Si le graphisme de Gabriel Rodriguez est particulièrement soigné, c’est l’écriture rythmée de l’auteur qui m’a d’emblée séduite. Joe Hill jongle inlassablement avec les codes du fantastique, du gothique et de l’horreur qu’il maîtrise d’ailleurs avec brio. Il apporte à l’ensemble un suspense haletant. Certaines planches du livre m’ont par ailleurs données la chair de poule. Les scènes dédiées à la figure énigmatique de la dame du puits qui se présente initialement au petit Bode comme son écho, m’ont d’ailleurs franchement mises mal à l’aise. Ce personnage est terrifiant…
Certaines planches du livre m’ont par ailleurs données la chair de poule. Les scènes dédiées à la figure énigmatique de la dame du puits qui se présente initialement au petit Bode comme son écho, m’ont d’ailleurs franchement mises mal à l’aise. Ce personnage est terrifiant…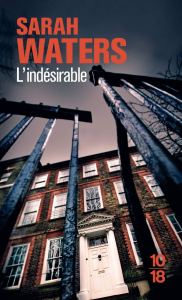

 Un dernier mot sur l’adaptation cinématographique : fidèle au livre, cette adaptation un brin intimiste pourtant passée inaperçue durant sa sortie en salle est selon moi plutôt réussie. La performance des acteurs tout en nuance est remarquable. L’esthétique du film est également sublime. Il est cependant regrettable que le réalisateur n’ait pas réussi à lui insuffler suffisamment de fougue. Le film manque parfois de rythme et le spectateur peine à comprendre l’intrigue trop tarabiscotée.
Un dernier mot sur l’adaptation cinématographique : fidèle au livre, cette adaptation un brin intimiste pourtant passée inaperçue durant sa sortie en salle est selon moi plutôt réussie. La performance des acteurs tout en nuance est remarquable. L’esthétique du film est également sublime. Il est cependant regrettable que le réalisateur n’ait pas réussi à lui insuffler suffisamment de fougue. Le film manque parfois de rythme et le spectateur peine à comprendre l’intrigue trop tarabiscotée.
 Etant actuellement plongée dans la série criminelle de Netflix Dirty Betty qui traite également d’abus au sein de la sphère maritale,
Etant actuellement plongée dans la série criminelle de Netflix Dirty Betty qui traite également d’abus au sein de la sphère maritale,  Je dois dire que cette série vaut vraiment le détour, à la différence du roman Femme sans merci. de Camilla Läckberg, les portraits psychologiques de Betty tout comme de son mari sont brossés avec une finesse exceptionnelle. L’ambiance très vintage, tout comme les costumes somptueux des personnages, sont un régal pour les yeux. Betty a un style particulièrement raffiné. Ses tenues sont à tomber!
Je dois dire que cette série vaut vraiment le détour, à la différence du roman Femme sans merci. de Camilla Läckberg, les portraits psychologiques de Betty tout comme de son mari sont brossés avec une finesse exceptionnelle. L’ambiance très vintage, tout comme les costumes somptueux des personnages, sont un régal pour les yeux. Betty a un style particulièrement raffiné. Ses tenues sont à tomber!
 Hier après-midi, se déroulait la réunion mensuelle de mon book club. L’une de mes amies membres du cercle m’a chaudement conseillé et gentiment prêté cette novella qui vient tout juste de paraître dans la collection Actes Sud. Je ne raffole guère des romans policiers, encore moins lorsqu’ils plantent leur intrigue dans un décor froid d’un pays nordique lointain. Ces romans à l’atmosphère claustrophobe me glacent habituellement. Cependant, j’ai décidé de sortir en ce moment un peu de ma zone de confort pour me tourner vers une lecture axée sur le polar. Je dois avouer que le sujet de cette lecture agréable et initialement alléchant s’est révélé somme toute un brin prévisible…
Hier après-midi, se déroulait la réunion mensuelle de mon book club. L’une de mes amies membres du cercle m’a chaudement conseillé et gentiment prêté cette novella qui vient tout juste de paraître dans la collection Actes Sud. Je ne raffole guère des romans policiers, encore moins lorsqu’ils plantent leur intrigue dans un décor froid d’un pays nordique lointain. Ces romans à l’atmosphère claustrophobe me glacent habituellement. Cependant, j’ai décidé de sortir en ce moment un peu de ma zone de confort pour me tourner vers une lecture axée sur le polar. Je dois avouer que le sujet de cette lecture agréable et initialement alléchant s’est révélé somme toute un brin prévisible…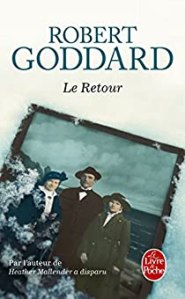



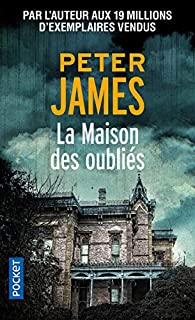 Je déclare officiellement la saison halloweeniene ouverte ! Je l’attendais avec impatience ! Le temps s’accorde d’ailleurs à merveille à cette occasion. En Normandie, une pluie fine associée à une bourrasque fraîche s’est progressivement installée. Les jours se raccourcissent peu à peu, la luminosité baisse et les feux de cheminées ont repris ! J’ai donc retrouvé avec plaisir mon petit rythme de croisière de lectures automnales en me plongeant dans quelques œuvres frissonnantes. Mon choix s’est tout naturellement porté sur ce roman, une histoire glaçante de hantise :
Je déclare officiellement la saison halloweeniene ouverte ! Je l’attendais avec impatience ! Le temps s’accorde d’ailleurs à merveille à cette occasion. En Normandie, une pluie fine associée à une bourrasque fraîche s’est progressivement installée. Les jours se raccourcissent peu à peu, la luminosité baisse et les feux de cheminées ont repris ! J’ai donc retrouvé avec plaisir mon petit rythme de croisière de lectures automnales en me plongeant dans quelques œuvres frissonnantes. Mon choix s’est tout naturellement porté sur ce roman, une histoire glaçante de hantise :
 On y retrouve d’ailleurs une atmosphère troublante qui m’a étrangement rappelé celle de la Twilight Zone. Cette demeure étrange semble le portail d’une autre dimension où le temps perd toute linéarité. Le lecteur se sent de ce fait lui-même désorienté tout comme les personnages qui ne savent plus sur quel pied danser. Cette vieille bâtisse possède tellement de chambres, de recoins et de couloirs qu’elle en devient un véritable labyrinthe. Comment ne pas penser alors à The haunting of Hill house, cette série extraordinaire et terrifiante sans effusions de sang ni gore (disponible sur Netflix), un chef-d’œuvre d’écriture et un hommage excellent aux récits de hantises de Shirley Jackson, qui relate aussi l’emménagement d’une petite famille dans une demeure vétuste et mystérieuse… Si vous êtes passé à côté de cette pépite, je vous conseille de la découvrir dès maintenant. L’intrigue est remarquable.
On y retrouve d’ailleurs une atmosphère troublante qui m’a étrangement rappelé celle de la Twilight Zone. Cette demeure étrange semble le portail d’une autre dimension où le temps perd toute linéarité. Le lecteur se sent de ce fait lui-même désorienté tout comme les personnages qui ne savent plus sur quel pied danser. Cette vieille bâtisse possède tellement de chambres, de recoins et de couloirs qu’elle en devient un véritable labyrinthe. Comment ne pas penser alors à The haunting of Hill house, cette série extraordinaire et terrifiante sans effusions de sang ni gore (disponible sur Netflix), un chef-d’œuvre d’écriture et un hommage excellent aux récits de hantises de Shirley Jackson, qui relate aussi l’emménagement d’une petite famille dans une demeure vétuste et mystérieuse… Si vous êtes passé à côté de cette pépite, je vous conseille de la découvrir dès maintenant. L’intrigue est remarquable.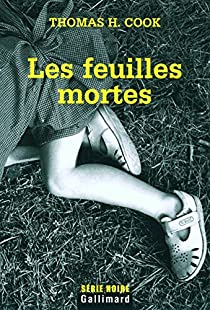 L’automne se profilant doucement à l’horizon, ce titre de roman me semblait tout à fait à propos pour me mettre au diapason. Mon book club mensuel avait désigné ce mois-ci le roman policier/thriller comme thématique principale, une occasion rêvée pour renouer avec mon plaisir de lecture en extirpant de ma PAL un nouveau roman de Thomas H. Cook. Je garde de cet auteur un souvenir agréable si ce n’est mémorable. J’avais lu avec un certain plaisir
L’automne se profilant doucement à l’horizon, ce titre de roman me semblait tout à fait à propos pour me mettre au diapason. Mon book club mensuel avait désigné ce mois-ci le roman policier/thriller comme thématique principale, une occasion rêvée pour renouer avec mon plaisir de lecture en extirpant de ma PAL un nouveau roman de Thomas H. Cook. Je garde de cet auteur un souvenir agréable si ce n’est mémorable. J’avais lu avec un certain plaisir 
 Après une longue absence sur la blogosphère due à une année particulièrement chargée, je profite de cette parenthèse inédite que nous offre paradoxalement ce confinement historique pour revenir vers vous et vous faire part de mes toutes dernières lectures.
Après une longue absence sur la blogosphère due à une année particulièrement chargée, je profite de cette parenthèse inédite que nous offre paradoxalement ce confinement historique pour revenir vers vous et vous faire part de mes toutes dernières lectures. Qu’à cela ne tienne, cette œuvre foisonnante empreinte de mystère, une ode à la littérature, est pour moi un grand coup de cœur. Une lecture chronophage que j’ai engloutie en quelques jours. J’ai également lu Marina avec avidité, quand bien même l’écriture tout comme l’intrigue fantastique semblent à mon sens moins abouties. Cette lecture séduira assurément le jeune public et demeure une bonne introduction à l’œuvre de Carlos Ruiz Zafon. J’ai bien entendu aimé retrouver la plume fluide de cet écrivain espagnol tout comme cet univers baroque envoutant.
Qu’à cela ne tienne, cette œuvre foisonnante empreinte de mystère, une ode à la littérature, est pour moi un grand coup de cœur. Une lecture chronophage que j’ai engloutie en quelques jours. J’ai également lu Marina avec avidité, quand bien même l’écriture tout comme l’intrigue fantastique semblent à mon sens moins abouties. Cette lecture séduira assurément le jeune public et demeure une bonne introduction à l’œuvre de Carlos Ruiz Zafon. J’ai bien entendu aimé retrouver la plume fluide de cet écrivain espagnol tout comme cet univers baroque envoutant. Voici une lecture pour le Mois anglais, qui se prêtait merveilleusement bien au climat ambiant de cette saison. Le temps demeure ici en Normandie plutôt morose avec des températures un peu fraîches et l’humidité persiste malgré l’annonce de l’été imminent… Où se cache donc le soleil !? Aussi je n’éprouve qu’une envie, me calfeutrer sous un plaid, en compagnie d’un bon roman et d’une tasse de thé réconfortante… Pour cette troisième participation, j’ai choisi de dépoussiérer un classique « vintage », une œuvre culte, poétique et singulière dont j’ai grandement apprécié la lecture…
Voici une lecture pour le Mois anglais, qui se prêtait merveilleusement bien au climat ambiant de cette saison. Le temps demeure ici en Normandie plutôt morose avec des températures un peu fraîches et l’humidité persiste malgré l’annonce de l’été imminent… Où se cache donc le soleil !? Aussi je n’éprouve qu’une envie, me calfeutrer sous un plaid, en compagnie d’un bon roman et d’une tasse de thé réconfortante… Pour cette troisième participation, j’ai choisi de dépoussiérer un classique « vintage », une œuvre culte, poétique et singulière dont j’ai grandement apprécié la lecture…
 Un dernier mot sur l’adaptation : Ce petit bijou du cinéma mêle habilement le fantastique au romantique. Certains pourraient trouver à redire sur la mièvrerie de la mise en scène, qui empiète sans-doute parfois un peu trop sur l’histoire ; et même s’il est vrai que le jeu maniéré de Gene Tierney m’a parfois déroutée, il n’a cependant en rien entravé mon plaisir de visionner ce film qui demeure encore selon moi une œuvre culte. Gene Tierney et Rex Harrison forment un duo remarquable. J’ai aussi aimé la bande-originale du film, envoûtante, mystérieuse et intrigante à souhait, qui ponctue avec brio l’intrigue… Si vous aimez ce film, je vous recommande aussi chaudement le film Dragonwick dans la même veine et dans lequel Gene Tierney, cette beauté funeste, incarne une fois de plus le rôle-titre.
Un dernier mot sur l’adaptation : Ce petit bijou du cinéma mêle habilement le fantastique au romantique. Certains pourraient trouver à redire sur la mièvrerie de la mise en scène, qui empiète sans-doute parfois un peu trop sur l’histoire ; et même s’il est vrai que le jeu maniéré de Gene Tierney m’a parfois déroutée, il n’a cependant en rien entravé mon plaisir de visionner ce film qui demeure encore selon moi une œuvre culte. Gene Tierney et Rex Harrison forment un duo remarquable. J’ai aussi aimé la bande-originale du film, envoûtante, mystérieuse et intrigante à souhait, qui ponctue avec brio l’intrigue… Si vous aimez ce film, je vous recommande aussi chaudement le film Dragonwick dans la même veine et dans lequel Gene Tierney, cette beauté funeste, incarne une fois de plus le rôle-titre.
 Bruxelles, juin 1815.
Bruxelles, juin 1815.
 Pour ouvrir le bal cette année, pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups en célébrant par la même occasion le D-Day qui sera commémoré ce 6 juin ? Résidant en Normandie, je vois depuis peu défiler sous mes fenêtres nombre de voitures vintages ou de véhicules militaires d’époque. La Seconde Guerre Mondiale étant une période historique à laquelle j’ai toujours été particulièrement sensible, je suis donc ce festival de près. De plus, ce contexte reste une mine intarissable d’inspiration pour la fiction… L’occasion semblait donc propice à lire cette petite romance historique, un moyen de participer à ma manière au devoir de mémoire…
Pour ouvrir le bal cette année, pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups en célébrant par la même occasion le D-Day qui sera commémoré ce 6 juin ? Résidant en Normandie, je vois depuis peu défiler sous mes fenêtres nombre de voitures vintages ou de véhicules militaires d’époque. La Seconde Guerre Mondiale étant une période historique à laquelle j’ai toujours été particulièrement sensible, je suis donc ce festival de près. De plus, ce contexte reste une mine intarissable d’inspiration pour la fiction… L’occasion semblait donc propice à lire cette petite romance historique, un moyen de participer à ma manière au devoir de mémoire…
 Un dernier mot sur le film de James Kent : le cinéaste s’est attelé non sans mal à son adaptation. Mais étant servie par une distribution séduisante, je n’ai pu résister à la tentation de me précipiter en salle pour voir le résultat. La réalisation est plutôt sobre, aussi ce long-métrage manque-t-il selon moi de véritable souffle romanesque. Jane Campion (La leçon de piano) ou même Joe Wright (Reviens-moi) auraient sans-doute mieux exploité la fibre romantique parfois trop figée, et lui auraient apporté davantage de nuances.
Un dernier mot sur le film de James Kent : le cinéaste s’est attelé non sans mal à son adaptation. Mais étant servie par une distribution séduisante, je n’ai pu résister à la tentation de me précipiter en salle pour voir le résultat. La réalisation est plutôt sobre, aussi ce long-métrage manque-t-il selon moi de véritable souffle romanesque. Jane Campion (La leçon de piano) ou même Joe Wright (Reviens-moi) auraient sans-doute mieux exploité la fibre romantique parfois trop figée, et lui auraient apporté davantage de nuances.


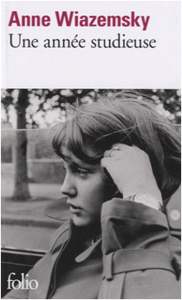 Ayant eu plus de temps libre ces temps-ci, j’ai décidé de dépoussiérer ma bibliothèque pour effectuer un grand ménage de printemps et d’attaquer par la même occasion ma copieuse pile de livres, qui ne cesse de grossir au fil des ans. Je lorgnais cette lecture depuis un moment déjà, et il était donc grand temps de m’y attaquer. J’avais fait l’acquisition de ce roman autobiographique après avoir visionné le film Le Mépris de Godard lorsque je m’étais soudainement prise d’intérêt pour son univers cinématographique éparpillé qui, je dois bien l’admettre, m’intrigue toujours autant qu’il me fascine. Ce cinéaste insaisissable me laisse encore aujourd’hui songeuse… Est-il un pur géni visionnaire et incompris ou un vulgaire bobo snobinard ? Il faut bien l’admettre, lorsqu’on évoque son art, les avis sont souvent partagés.
Ayant eu plus de temps libre ces temps-ci, j’ai décidé de dépoussiérer ma bibliothèque pour effectuer un grand ménage de printemps et d’attaquer par la même occasion ma copieuse pile de livres, qui ne cesse de grossir au fil des ans. Je lorgnais cette lecture depuis un moment déjà, et il était donc grand temps de m’y attaquer. J’avais fait l’acquisition de ce roman autobiographique après avoir visionné le film Le Mépris de Godard lorsque je m’étais soudainement prise d’intérêt pour son univers cinématographique éparpillé qui, je dois bien l’admettre, m’intrigue toujours autant qu’il me fascine. Ce cinéaste insaisissable me laisse encore aujourd’hui songeuse… Est-il un pur géni visionnaire et incompris ou un vulgaire bobo snobinard ? Il faut bien l’admettre, lorsqu’on évoque son art, les avis sont souvent partagés.

 Pour conclure, si cette lecture m’a plutôt plu, je n’ai pourtant pas éprouvé l’envie de lire le second volet, Une année après. J’ai cependant visionné son adaptation cinématographique très cynique de Michel Hazanavicius, un réalisateur que j’apprécie grandement après avoir découvert la saga comique et décalée d’OSS 117. Le cinéaste immortalise ici avec panache la personnalité excessive de Godard dans sa parodie burlesque Le Redoutable, qui prend pour toile de fond Mai 68. Anne Wiazemski aurait d’ailleurs adoubé cette adaptation libre et loufoque. Le réalisateur populaire démystifie le cinéaste souvent trop verbeux pour le réduire à une peau de chagrin, un projet fou et un peu culotté qui m’a tout de suite séduite. Il se moque également avec malice des idées fumeuses pseudo-maoïstes ou marxistes de Godard. J’ai trouvé le film un brin kitsch très original, et certains passages m’ont fait doucement sourire, en particulier lorsque la voix nasillarde de Godard, incarné sous les traits de Louis Garrel méconnaissable, (quel meilleur choix que le fils d’un cinéaste de la nouvelle vague pour interpréter ce rôle !), s’interroge sur ses choix artistiques hasardeux : à quel moment a-t-il vraiment perdu pied ? Ce portrait au vitriol du cinéaste est un pur régal ! Complice du système, cette gauche caviar dont il est pourtant le pur produit, Godard évolue dans un univers qui frise parfois le ridicule, un monde où l’artiste incompris peine à trouver sa place, constamment déchiré entre sa passion reniée pour le 7ème art, une activité très bourgeoise, et ses convictions paradoxalement anticapitalistes.
Pour conclure, si cette lecture m’a plutôt plu, je n’ai pourtant pas éprouvé l’envie de lire le second volet, Une année après. J’ai cependant visionné son adaptation cinématographique très cynique de Michel Hazanavicius, un réalisateur que j’apprécie grandement après avoir découvert la saga comique et décalée d’OSS 117. Le cinéaste immortalise ici avec panache la personnalité excessive de Godard dans sa parodie burlesque Le Redoutable, qui prend pour toile de fond Mai 68. Anne Wiazemski aurait d’ailleurs adoubé cette adaptation libre et loufoque. Le réalisateur populaire démystifie le cinéaste souvent trop verbeux pour le réduire à une peau de chagrin, un projet fou et un peu culotté qui m’a tout de suite séduite. Il se moque également avec malice des idées fumeuses pseudo-maoïstes ou marxistes de Godard. J’ai trouvé le film un brin kitsch très original, et certains passages m’ont fait doucement sourire, en particulier lorsque la voix nasillarde de Godard, incarné sous les traits de Louis Garrel méconnaissable, (quel meilleur choix que le fils d’un cinéaste de la nouvelle vague pour interpréter ce rôle !), s’interroge sur ses choix artistiques hasardeux : à quel moment a-t-il vraiment perdu pied ? Ce portrait au vitriol du cinéaste est un pur régal ! Complice du système, cette gauche caviar dont il est pourtant le pur produit, Godard évolue dans un univers qui frise parfois le ridicule, un monde où l’artiste incompris peine à trouver sa place, constamment déchiré entre sa passion reniée pour le 7ème art, une activité très bourgeoise, et ses convictions paradoxalement anticapitalistes. Publié pour la première fois en 1967, Le pouvoir du chien est un roman américain devenu culte, qui, pour d’obscures raisons, fut durant de nombreuses années, boudé par la critique tout comme par les éditions françaises. Pourquoi donc ce roman magistral est-il resté si longtemps inaperçu ? Il semble que les années 60, ancrées dans un climat social encore particulièrement sexiste, ne pouvait supporter l’idée d’une possible remise en cause quelque peu subversive du mythe de John Wayne, l’incarnation du cow-boy viril et misogyne, considérée jusqu’alors intouchable. Il faut l’admettre, l’auteur n’y va pas avec le dos de la cuillère pour esquinter cette icône… Il aura d’ailleurs fallu attendre le succès d’abord littéraire puis cinématographique retentissant de Brokeback Mountain en 2005 pour ouvrir la voie à ce genre de littérature. Les éditions Gallmeisteir connues pour leurs couvertures rétro nous en proposent donc ici une nouvelle version, avec une traduction exclusive et particulièrement soignée afin de compenser ce mal.
Publié pour la première fois en 1967, Le pouvoir du chien est un roman américain devenu culte, qui, pour d’obscures raisons, fut durant de nombreuses années, boudé par la critique tout comme par les éditions françaises. Pourquoi donc ce roman magistral est-il resté si longtemps inaperçu ? Il semble que les années 60, ancrées dans un climat social encore particulièrement sexiste, ne pouvait supporter l’idée d’une possible remise en cause quelque peu subversive du mythe de John Wayne, l’incarnation du cow-boy viril et misogyne, considérée jusqu’alors intouchable. Il faut l’admettre, l’auteur n’y va pas avec le dos de la cuillère pour esquinter cette icône… Il aura d’ailleurs fallu attendre le succès d’abord littéraire puis cinématographique retentissant de Brokeback Mountain en 2005 pour ouvrir la voie à ce genre de littérature. Les éditions Gallmeisteir connues pour leurs couvertures rétro nous en proposent donc ici une nouvelle version, avec une traduction exclusive et particulièrement soignée afin de compenser ce mal.


